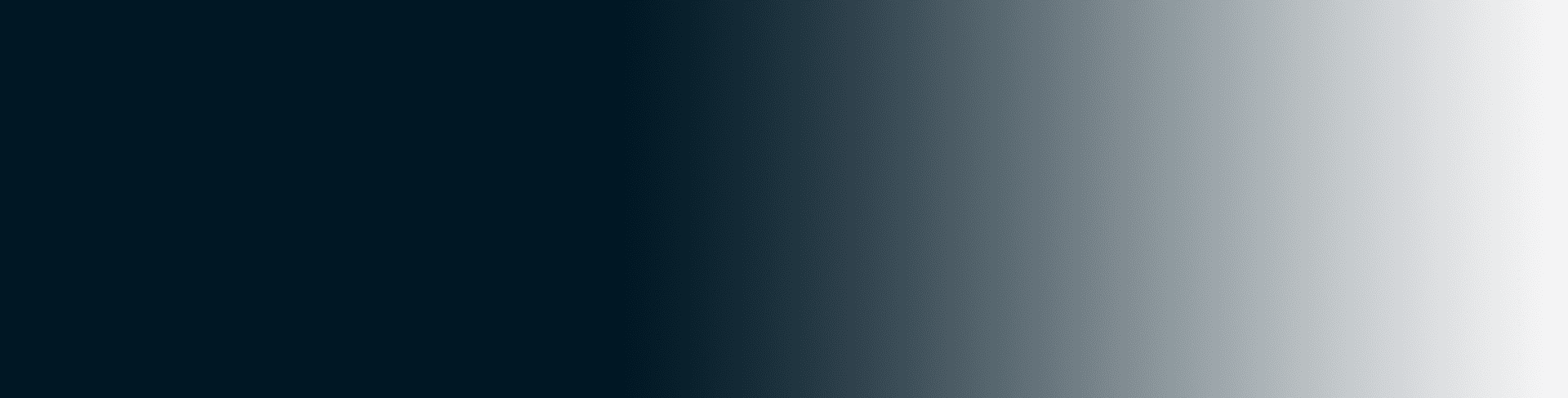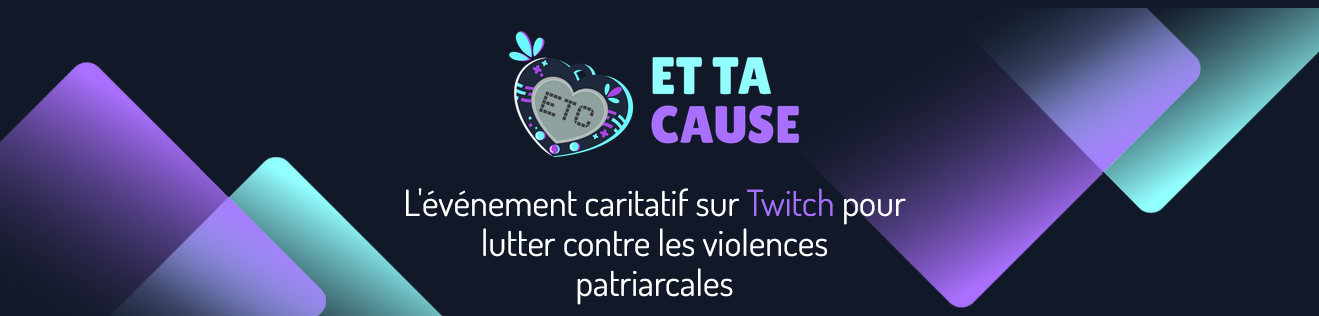« Moi, j’adore les jeux-vidéos, je suis un·e gamer·euse ! ».
Ça y est, votre interlocuteur·ice vous regarde avec un air d’incompréhension, voire de mépris. Iel s’imagine déjà que vous passez vos nuits dans votre chambre de 5 m², les yeux rivés sur votre écran d’ordinateur, à parler tout·e seul·e en exterminant une horde de zombies qui n’a rien demandé.
On la connaît cette image négative du gamer qui colle encore -trop- souvent à la peau des joueur·euses. Ce que vous ne savez pas, c’est que votre voisin·e méprisant·e est également un·e joueur·euse parce qu’iel adore s’occuper de son chat virtuel sur son téléphone portable.
En réalité, nous sommes tous·tes des gamer·euses.
Tous·tes des joueur·euses ?!
Cela peut vous sembler étrange. Je vous vois déjà lever les yeux au ciel en soupirant : « n’importe quoi ! ». Et pourtant. Toi qui aimes jouer à Candy Crush dans la salle d’attente de ton dentiste, toi qui as déjà passé des heures sur Tetris, ton neveu qui s’amuse sur Minecraft avec ses copains du collège ou ta sœur qui arpente les sites de jeux en ligne. Ton petit ami qui ne lâche sa PS5 pour rien au monde, surtout quand il s’agit de s’évader dans un monde ouvert, mais aussi ta mamie qui joue au Solitaire sur sa tablette.
Il y a autant de jeux vidéo que de joueur·euses, raison pour laquelle Game’Her existe, par ailleurs.
« Mais il n’y a que 3 milliards de joueur·euses (chiffres 2025) pour 8 milliards d’êtres humains, c’est n’importe quoi ! », s’exclament déjà mes détracteur·ices. D’abord, seule 68 % de la population mondiale a accès à Internet. « Alors pourquoi n’avons-nous pas 5.44 milliards de joueur·euses ? », peut-on rétorquer.
Il convient de nuancer le propos, non seulement il existe de nombreux jeux vidéo qui ne nécessitent aucune connexion internet, à l’image des jeux d’arcades et des consoles portatives à cartouche, par exemple. Aussi, il est impossible de réaliser une étude d’une ampleur aussi grande, donc ces chiffres ne sont que des estimations, et de nombreuses personnes n’ont tout simplement pas accès aux jeux-vidéos.
Nous nous concentrons ici sur les personnes qui vivent dans une société ou un pays où les jeux vidéo sont communs et accessibles facilement, et plus particulièrement les pays européens, qui disposent de davantage de données.
On sait que seuls 32 % des personnes qui ont entre 45 et 64 ans jouent à des jeux vidéo en Europe, mais ces chiffres ne nient pas que nous sommes tous·tes des joueur·euses. En France, 67 % des femmes jouent aux jeux vidéo. Elles représentent 18.8 millions de joueuses sur 39.1 millions.
Nous l’avons été, nous le sommes, ou nous le deviendrons.
Être ou ne pas être joueur·euse
De nombreux·ses joueur·euses s’ignorent, voire mettent à distance l’image traditionnelle du gamer pour ne pas y être assimilé·es. Qui aurait envie de ressembler à cet adolescent boutonneux qui s’enferme dans sa chambre ou ce jeune homme qui hurle devant sa télévision à 2h00 du matin, car il enchaîne les défaites sur Fortnite ? Oui, ce sont des clichés. Et ils ont la vie dure.
Accepter de faire partie du groupe social des joueur·euses de jeux vidéo, c’est également prendre le risque de subir de nouvelles violences dirigées envers ce groupe. Une réalité d’autant plus concrète pour les joueuses, victimes de sexisme de la part des joueurs.

Dès lors, il n’est pas si incompréhensible que les joueuses préfèrent ne pas se déclarer en tant que telle. Si je demande à ma grand-mère si elle se considère comme joueuse de jeux vidéo, il est fort à parier qu’elle me réponde qu’elle ne pense pas être une gameuse. Pourtant, toutes les heures qu’elle a déjà passé devant le Mah-Jong, le Solitaire ou même des petits jeux en ligne font bel et bien d’elle une joueuse. Ta tante qui s’amuse à faire grandir une ferme et te demande de lui envoyer des vies sur Facebook tous les jours est, elle aussi, une joueuse. Il en va de même pour cette adolescente qui adore construire des maisons dans Les Sims, ou ton amie qui suit toutes les aventures de Geralt of Rivia sans relâche.
Jouer, ce n’est pas réservé aux hommes, ni aux personnes valides, ni aux personnes neurotypiques, ni aux personnes blanches, etc. Tout le monde peut jouer, et être un·e joueur·euse.
Jouer, c’est fun
Non seulement, nous avons tous·tes déjà joué à un jeu vidéo au moins une fois dans notre vie, mais il y a fort à parier que nous y avons déjà pris du plaisir. Vous avez probablement déjà entendu parler du système de récompense dont raffole notre cerveau, quand il effectue une tâche, puisqu’il est récompensé par une animation, de nouveaux skins*, un niveau qui se dévoile, etc. Et tout ceci n’est pas anodin, ni sans raison.
Les équipes qui se chargent de créer les jeux vidéo font tout ce qui est en leur pouvoir pour rendre leurs productions attractives. Game design, UX design, narration des niveaux, développeur·euses : iels sont nombreux·ses à penser à votre expérience de jeu. S’évader de son quotidien, plonger dans une œuvre que l’on adore, rencontrer des personnes à l’autre bout du monde, devenir une héroïne, un héros ou simplement dépasser toutes les limites du réel : les raisons qui font que l’on aime les jeux vidéo sont multiples.

Alors, si cela nous permet de passer du bon temps, de nous amuser et d’apprendre des choses, pourquoi nous n'assumons pas qu’on aime ça, les jeux vidéo ? La majorité des gens ont une expérience avec les jeux vidéo, et sûrement au moins un souvenir positif passé sur un jeu. OK, tout le monde n’est pas forcément passionné au sens traditionnel du terme, mais il faut aussi noter que la gamification* commence à s’immiscer de plus en plus dans notre quotidien.
Pourquoi ? Parce que jouer, c’est fun.
Et quand on veut vendre un produit à quelqu'un, ou faire en sorte qu’un public passe un bon moment dans un musée, on mise sur le côté ludique. C’est notamment le cas avec des applications éducatives, comme Duolingo ou Memrise, qui misent sur un système vidéoludique. Pour apprendre une langue, il faut acquérir des points d’expérience (XP), monter des niveaux, effectuer des séries d’apprentissage consécutives, tenter d’être le meilleur dans le classement… Ça ne vous rappelle rien ?
On peut aussi noter l’application Habitica, qui transforme notre To-Do List en un jeu de rôle. On crée un personnage qui gagne de l’expérience et des points d’attaque au fur et à mesure que l’on accomplit nos tâches. Si on échoue, notre protagoniste subit des dégâts.
Les entreprises misent de plus en plus sur le jeu vidéo pour vous aider à accomplir des tâches que vous n’aimez pas faire en temps normal. Transformer quelque chose de barbant en jeu, c’est automatiquement l’associer à du positif : on vous donne envie d’y revenir.
La grande famille du jeu vidéo
Vous l’aurez compris en lisant ces lignes, je suis un fervent joueur de jeux vidéo, et je ne cherche qu’à vous faire comprendre que vous et moi, on appartient à la même famille de joueur·euses. Tout le monde est bienvenu ici.
Jouer à des jeux vidéo, ce n’est plus l'apanage de quelques spécialistes, ce n’est pas seulement les RPG et les FPS, le jeu s’est infiltré dans notre quotidien. Les jeux vidéo nous motivent, nous divertissent, nous éduquent et nous rapprochent les un·es des autres.
Alors, la prochaine fois que vous croiserez quelqu'un sur son téléphone ou sa console, rappelez-vous que vous faites probablement partie de la même communauté. Peut-être est-il temps d'assumer, et de célébrer, le fait que nous sommes tou·tes des joueur·euses.
*skins = apparences que l’on peut débloquer en jeu pour un personnage ou des éléments
*gamification = stratégie qui utilise les mécaniques de jeu, hors de son contexte de base et s’applique à tous les secteurs. Cela passe par un système de points, de niveaux, d’expérience, d’objectifs à atteindre, etc.